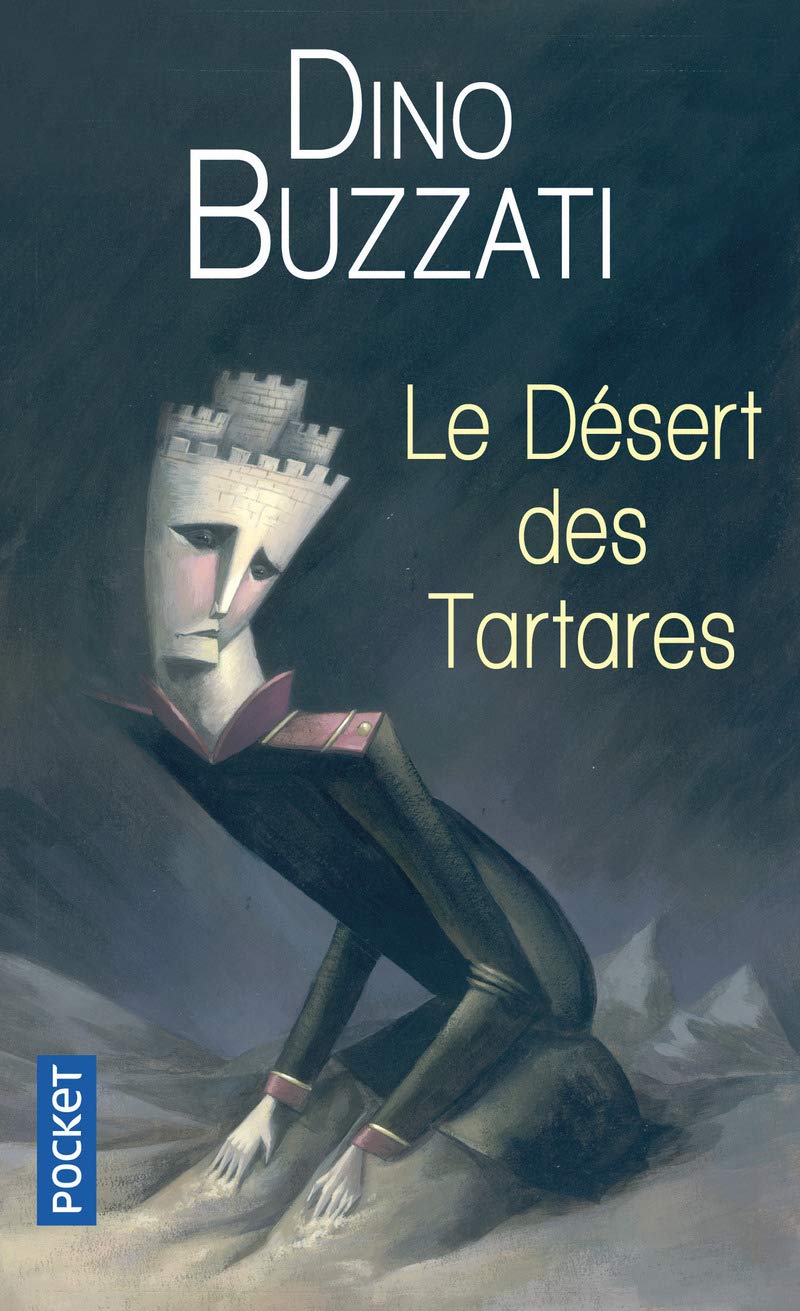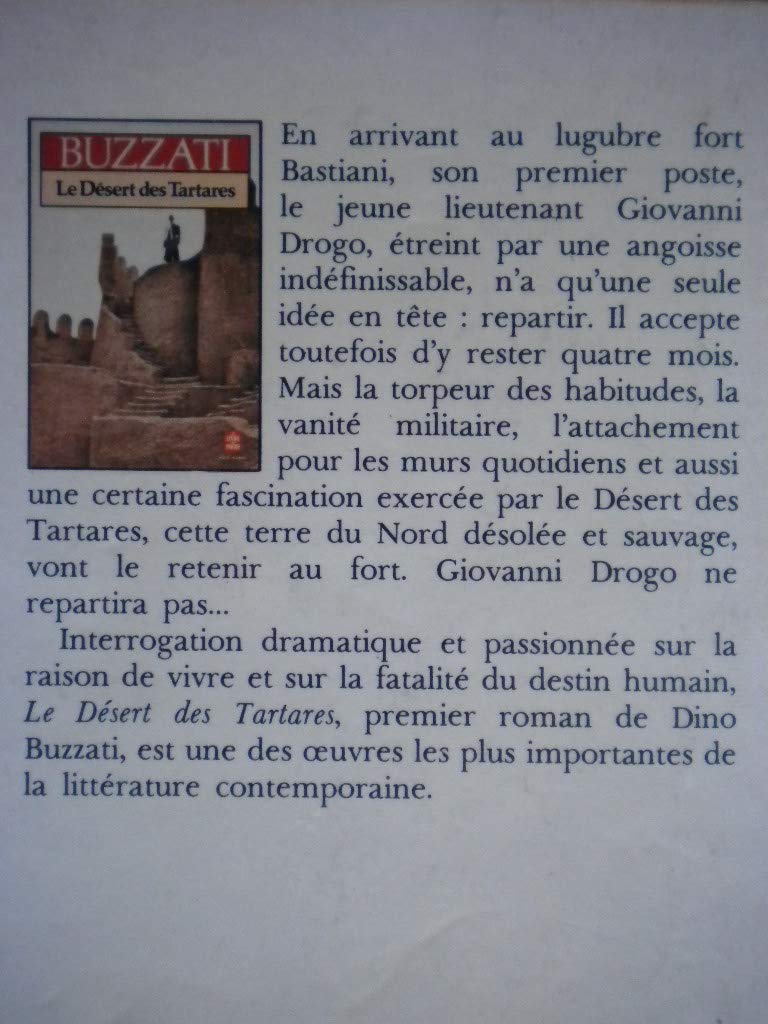Le désert des Tartares
Dino Buzzati
(IL DESERTO DEI TARTARI)
(IL DESERTO DEI TARTARI)
*
Le fort était silencieux, noyé dans le plein soleil de midi, sans un seul coin d’ombre. Ses murs (la façade qui était tournée vers le nord était invisible) s’étendaient nus et jaunâtres. Une cheminée crachait une pâle fumée. Tout le long du chemin de ronde du bâtiment central, à la crête des murs et des redoutes, on apercevait des dizaines de factionnaires, le fusil sur l’épaule, qui marchaient méthodiquement de long en large, chacun ne parcourant que quelques pas. Tel le mouvement d’un pendule, ils scandaient le cours du temps, sans rompre l’enchantement de cette solitude qui semblait infinie.
Les montagnes, à droite et à gauche, se prolongeaient à perte de vue en chaînes escarpées, apparemment inaccessibles. Elles aussi, du moins à cette heure-là, avaient une couleur jaune et calcinée.
…
Et derrière, qu’y avait-il ? Par-delà cet édifice inhospitalier, par-delà ces merlons, ces casemates, ces poudrières, qui obstruaient la vue, quel monde s’ouvrait ? A quoi ressemblait ce Royaume du Nord, ce désert pierreux par où personne n’était jamais passé ? La carte, Drogo se le rappelait vaguement, indiquait de l’autre côté de la frontière une vaste zone où il n’y avait que très peu de noms, mais du haut du fort verrait-on au moins quelques localités, quelques champs, une maison, ou seulement la désolation d’une lande inhabitée ?
...
- Mon commandant, demanda-t-il d’une voix calme en apparence, est-ce que je puis jeter un coup d’oeil au nord, voir ce qu’il y a par-delà ces murs ?
- Par-delà ces murs ? Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux panoramas, répondit le commandant.
- Rien qu’un coup d’œil, mon commandant, par simple curiosité. J’ai entendu dire qu’il y a un désert et, moi, des déserts je n’en ai jamais vu.
- Ça ne vaut pas la peine, lieutenant. Un paysage monotone, vraiment rien de beau. Croyez-moi, n’y pensez pas !
- Je n’insiste pas, mon commandant, fit Drogo. Je ne croyais pas que cela présentât de difficultés.
Le commandant Matti joignit le bout de ses doigts grassouillets, presque en un geste de prière.
- Vous m’avez justement demandé, dit-il, l’unique chose que je ne puis vous accorder.
**
Ici, par contre, s’avançait la grande nuit des montagnes, avec ses nuages en fuite au-dessus du fort, miraculeux présages. Et du Nord, du Septentrion invisible derrière les remparts, Drogo sentait peser son destin.
Le docteur était déjà sur le seuil.
-Docteur, docteur, dit Drogo balbutiant presque. Je me porte bien.
- Je le sais, répondit le médecin. Que pensiez-vous donc ?
- Je me porte bien, répéta Drogo reconnaissant à peine sa propre voix. Je me porte bien et je veux rester.
- Rester ici, au fort ? Vous ne voulez plus partir ? Que vous est-il arrivé ?
-Je ne sais pas, dit Giovanni. Mais je ne peux pas partir.
- Oh ! s’exclama Rovina en s’approchant. Si ce n’est pas une plaisanterie, je vous jure que je suis content.
- Non, ce n’est pas une plaisanterie, fit Drogo qui sentait son exaltation se transformer en une étrange douleur, proche de la félicité. Docteur, jetez ce papier.
***
En bas, dans la chambre de l’officier de service, à l’intérieur de la redoute, la lampe était restée allumée, la flamme oscillait légèrement, faisant danser les ombres. Drogo, quelques instants plus tôt, avait commencé d’écrire une lettre, il devait répondre à Maria, la soeur de son ami Vescovi, qui un jour peut-être serait sa femme. Mais, après avoir écrit deux lignes, il s’était levé, il ne savait même pas pourquoi, et était monté sur le toit, pour regarder.
…
Que de temps devant lui ! Une seule année lui paraissait déjà interminable, et les bonnes années venaient à peine de commencer ; elles semblaient former une série illimitée dont on ne pouvait apercevoir le terme, un trésor encore intact et si grand qu’on pouvait courir le risque de s’ennuyer un peu.
Il n’y avait personne pour lui dire : « Prends garde, Giovanni Drogo ! » Illusion tenace, la vie lui semblait inépuisable, bien que sa jeunesse eût déjà commencé de se faner. Mais Drogo ignorait ce qu’était le temps. Eût-il même eu devant lui des centaines et des centaines d’années de jeunesse, tels les dieux, sa part aurait été tout aussi maigre. Et lui, au contraire, n’avait à sa disposition qu’une vie simple et normale, une petite jeunesse humaine, don avare, dont on pouvait compter les années sur les doigts de la main et qui aurait fondu avant même que l’on pût le connaître.
« Que de temps devant moi », pensait-il. Et pourtant, il avait entendu dire qu’il existait des hommes qui, à un certain moment (chose curieuse à dire), se mettaient à attendre la mort, cette chose connue et absurde qui ne pouvait le concerner. Drogo souriait, en y pensant, et cependant, poussé par le froid, il s’était mis à marcher.
****
Puis il alla voir Maria, la soeur de son ami Francesco Vescovi. La maison des Vescovi était entourée d’un jardin et, comme on était au printemps, les arbres avaient leurs nouvelles feuilles et, dans les branches, les petits oiseaux chantaient.
Maria vint à sa rencontre, sur le seuil, souriante. Elle avait appris qu’il allait venir et avait mis une robe bleue, serrée à la taille, semblable à une autre robe qu’il avait aimée jadis.
Drogo avait pensé que ç’allait être pour lui une grande émotion, que son coeur allait battre. Au lieu de cela, quand il fut près d’elle et qu’il revit son sourire, qu’il entendit le son de sa voix qui disait : « Oh ! Giovanni, enfin ! » (une voix si différente de celle qu’il avait imaginée), il put mesurer le temps qui s’était écoulé.
Il était le même qu’autrefois, croyait-il, peut-être un peu plus large d’épaules et hâlé par le soleil du fort. Elle non plus n’avait pas changé. Mais quelque chose s’était glissé entre eux.
…
-Oui, ce doit être beau, dit Maria en baissant les yeux. Mais, maintenant que nous sommes sur le point de partir, je n’en ai plus envie.
- Bêtises, c’est ce qui arrive toujours au dernier moment, c’est si ennuyeux de faire ses bagages, dit exprès Drogo, comme s’il n’avait pas saisi l’allusion sentimentale.
- Oh ! ce n’est pas à cause des bagages, ce n’est pas pour cela…
Il eût suffi d’un mot, d’une simple phrase pour lui dire que son départ lui faisait de la peine. Mais Drogo ne voulait rien demander, à ce moment-là, il n’en était vraiment pas capable, il aurait eu l’impression de mentir.
*****
Juste à cette époque, Drogo s’aperçut à quel point les hommes restent toujours séparés l’un de l’autre, malgré l’affection qu’ils peuvent se porter ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, sa douleur lui appartient en propre, nul ne peut l’en décharger si légèrement que ce soit ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand, et c’est cela qui fait la solitude de la vie.
******
L’obscurité a empli la chambre, ce n’est qu’à grand-peine que l’on peut distinguer la blancheur du lit et tout le reste est noir. Sous peu, la lune devrait se lever.
Drogo aura-t-il le temps de la voir ou faudra-t-il qu’il s’en aille avant ? La porte de la chambre a un frémissement et craque légèrement. Peut-être est-ce un courant d’air, un simple coup de vent comme il y en a par ces inquiètes nuits de printemps. Mais peut-être aussi est-ce Elle qui est entrée, à pas silencieux, et qui maintenant s’approche du fauteuil de Drogo. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d’une main le col de son uniforme, jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d’oeil, pour voir une dernière fois les étoiles. Puis, dans l’obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit.
Le fort était silencieux, noyé dans le plein soleil de midi, sans un seul coin d’ombre. Ses murs (la façade qui était tournée vers le nord était invisible) s’étendaient nus et jaunâtres. Une cheminée crachait une pâle fumée. Tout le long du chemin de ronde du bâtiment central, à la crête des murs et des redoutes, on apercevait des dizaines de factionnaires, le fusil sur l’épaule, qui marchaient méthodiquement de long en large, chacun ne parcourant que quelques pas. Tel le mouvement d’un pendule, ils scandaient le cours du temps, sans rompre l’enchantement de cette solitude qui semblait infinie.
Les montagnes, à droite et à gauche, se prolongeaient à perte de vue en chaînes escarpées, apparemment inaccessibles. Elles aussi, du moins à cette heure-là, avaient une couleur jaune et calcinée.
…
Et derrière, qu’y avait-il ? Par-delà cet édifice inhospitalier, par-delà ces merlons, ces casemates, ces poudrières, qui obstruaient la vue, quel monde s’ouvrait ? A quoi ressemblait ce Royaume du Nord, ce désert pierreux par où personne n’était jamais passé ? La carte, Drogo se le rappelait vaguement, indiquait de l’autre côté de la frontière une vaste zone où il n’y avait que très peu de noms, mais du haut du fort verrait-on au moins quelques localités, quelques champs, une maison, ou seulement la désolation d’une lande inhabitée ?
...
- Mon commandant, demanda-t-il d’une voix calme en apparence, est-ce que je puis jeter un coup d’oeil au nord, voir ce qu’il y a par-delà ces murs ?
- Par-delà ces murs ? Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux panoramas, répondit le commandant.
- Rien qu’un coup d’œil, mon commandant, par simple curiosité. J’ai entendu dire qu’il y a un désert et, moi, des déserts je n’en ai jamais vu.
- Ça ne vaut pas la peine, lieutenant. Un paysage monotone, vraiment rien de beau. Croyez-moi, n’y pensez pas !
- Je n’insiste pas, mon commandant, fit Drogo. Je ne croyais pas que cela présentât de difficultés.
Le commandant Matti joignit le bout de ses doigts grassouillets, presque en un geste de prière.
- Vous m’avez justement demandé, dit-il, l’unique chose que je ne puis vous accorder.
**
Ici, par contre, s’avançait la grande nuit des montagnes, avec ses nuages en fuite au-dessus du fort, miraculeux présages. Et du Nord, du Septentrion invisible derrière les remparts, Drogo sentait peser son destin.
Le docteur était déjà sur le seuil.
-Docteur, docteur, dit Drogo balbutiant presque. Je me porte bien.
- Je le sais, répondit le médecin. Que pensiez-vous donc ?
- Je me porte bien, répéta Drogo reconnaissant à peine sa propre voix. Je me porte bien et je veux rester.
- Rester ici, au fort ? Vous ne voulez plus partir ? Que vous est-il arrivé ?
-Je ne sais pas, dit Giovanni. Mais je ne peux pas partir.
- Oh ! s’exclama Rovina en s’approchant. Si ce n’est pas une plaisanterie, je vous jure que je suis content.
- Non, ce n’est pas une plaisanterie, fit Drogo qui sentait son exaltation se transformer en une étrange douleur, proche de la félicité. Docteur, jetez ce papier.
***
En bas, dans la chambre de l’officier de service, à l’intérieur de la redoute, la lampe était restée allumée, la flamme oscillait légèrement, faisant danser les ombres. Drogo, quelques instants plus tôt, avait commencé d’écrire une lettre, il devait répondre à Maria, la soeur de son ami Vescovi, qui un jour peut-être serait sa femme. Mais, après avoir écrit deux lignes, il s’était levé, il ne savait même pas pourquoi, et était monté sur le toit, pour regarder.
…
Que de temps devant lui ! Une seule année lui paraissait déjà interminable, et les bonnes années venaient à peine de commencer ; elles semblaient former une série illimitée dont on ne pouvait apercevoir le terme, un trésor encore intact et si grand qu’on pouvait courir le risque de s’ennuyer un peu.
Il n’y avait personne pour lui dire : « Prends garde, Giovanni Drogo ! » Illusion tenace, la vie lui semblait inépuisable, bien que sa jeunesse eût déjà commencé de se faner. Mais Drogo ignorait ce qu’était le temps. Eût-il même eu devant lui des centaines et des centaines d’années de jeunesse, tels les dieux, sa part aurait été tout aussi maigre. Et lui, au contraire, n’avait à sa disposition qu’une vie simple et normale, une petite jeunesse humaine, don avare, dont on pouvait compter les années sur les doigts de la main et qui aurait fondu avant même que l’on pût le connaître.
« Que de temps devant moi », pensait-il. Et pourtant, il avait entendu dire qu’il existait des hommes qui, à un certain moment (chose curieuse à dire), se mettaient à attendre la mort, cette chose connue et absurde qui ne pouvait le concerner. Drogo souriait, en y pensant, et cependant, poussé par le froid, il s’était mis à marcher.
****
Puis il alla voir Maria, la soeur de son ami Francesco Vescovi. La maison des Vescovi était entourée d’un jardin et, comme on était au printemps, les arbres avaient leurs nouvelles feuilles et, dans les branches, les petits oiseaux chantaient.
Maria vint à sa rencontre, sur le seuil, souriante. Elle avait appris qu’il allait venir et avait mis une robe bleue, serrée à la taille, semblable à une autre robe qu’il avait aimée jadis.
Drogo avait pensé que ç’allait être pour lui une grande émotion, que son coeur allait battre. Au lieu de cela, quand il fut près d’elle et qu’il revit son sourire, qu’il entendit le son de sa voix qui disait : « Oh ! Giovanni, enfin ! » (une voix si différente de celle qu’il avait imaginée), il put mesurer le temps qui s’était écoulé.
Il était le même qu’autrefois, croyait-il, peut-être un peu plus large d’épaules et hâlé par le soleil du fort. Elle non plus n’avait pas changé. Mais quelque chose s’était glissé entre eux.
…
-Oui, ce doit être beau, dit Maria en baissant les yeux. Mais, maintenant que nous sommes sur le point de partir, je n’en ai plus envie.
- Bêtises, c’est ce qui arrive toujours au dernier moment, c’est si ennuyeux de faire ses bagages, dit exprès Drogo, comme s’il n’avait pas saisi l’allusion sentimentale.
- Oh ! ce n’est pas à cause des bagages, ce n’est pas pour cela…
Il eût suffi d’un mot, d’une simple phrase pour lui dire que son départ lui faisait de la peine. Mais Drogo ne voulait rien demander, à ce moment-là, il n’en était vraiment pas capable, il aurait eu l’impression de mentir.
*****
Juste à cette époque, Drogo s’aperçut à quel point les hommes restent toujours séparés l’un de l’autre, malgré l’affection qu’ils peuvent se porter ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, sa douleur lui appartient en propre, nul ne peut l’en décharger si légèrement que ce soit ; il s’aperçut que, si quelqu’un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand, et c’est cela qui fait la solitude de la vie.
******
L’obscurité a empli la chambre, ce n’est qu’à grand-peine que l’on peut distinguer la blancheur du lit et tout le reste est noir. Sous peu, la lune devrait se lever.
Drogo aura-t-il le temps de la voir ou faudra-t-il qu’il s’en aille avant ? La porte de la chambre a un frémissement et craque légèrement. Peut-être est-ce un courant d’air, un simple coup de vent comme il y en a par ces inquiètes nuits de printemps. Mais peut-être aussi est-ce Elle qui est entrée, à pas silencieux, et qui maintenant s’approche du fauteuil de Drogo. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d’une main le col de son uniforme, jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d’oeil, pour voir une dernière fois les étoiles. Puis, dans l’obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit.